religion
« Horus : polysĂ©mie et mĂ©tamorphoses »
ENiM 6, 2013, p. 1-26.
 À l’instar du théonyme « Seth », le théonyme « Horus » est éminemment polysémique. Fondé sur l’analyse de plus de 900 attestations dans les Textes des Pyramides, cet article tente de classifier les différents référents théologiques, depuis le modèle archaïque, à portée historiographique, d’Horus de Hiéraconpolis jusqu’à l’élaboration de la figure d’Horus l’enfant héritier de son père Osiris. Au-delà du discours religieux, comme toujours, se laissent deviner les évolutions d’une pensée politique et les lourdes implications idéologiques de la diffusion du dogme osirien.
À l’instar du théonyme « Seth », le théonyme « Horus » est éminemment polysémique. Fondé sur l’analyse de plus de 900 attestations dans les Textes des Pyramides, cet article tente de classifier les différents référents théologiques, depuis le modèle archaïque, à portée historiographique, d’Horus de Hiéraconpolis jusqu’à l’élaboration de la figure d’Horus l’enfant héritier de son père Osiris. Au-delà du discours religieux, comme toujours, se laissent deviner les évolutions d’une pensée politique et les lourdes implications idéologiques de la diffusion du dogme osirien.
 Just as « Seth » appears to be, the god name « Horus » is an highly polysemic character. Through the analysis of over 900 occurrences in the Pyramid Texts, this paper attempts to classify the various theological referents, from the archaic model of Horus of Hieraconpolis – built for historiographical purpose – to the development of the character of Horus the child, heir of his father Osiris. Beyond the religious discourse, as usual, one can guess the trends of a political thought and the heavy ideological implications of the spread of the Osirian dogma.
Just as « Seth » appears to be, the god name « Horus » is an highly polysemic character. Through the analysis of over 900 occurrences in the Pyramid Texts, this paper attempts to classify the various theological referents, from the archaic model of Horus of Hieraconpolis – built for historiographical purpose – to the development of the character of Horus the child, heir of his father Osiris. Beyond the religious discourse, as usual, one can guess the trends of a political thought and the heavy ideological implications of the spread of the Osirian dogma.
 Consulter cet article (59340) -
Consulter cet article (59340) -  Télécharger cet article au format pdf (29928)
Télécharger cet article au format pdf (29928)
« Beyond the obvious: the Middle Kingdom sources and its contribution to the study of household religion in ancient Egypt »
ENiM 11, 2018, p. 23-32.
 La religion domestique dans l’Égypte ancienne a été le thème d’une recherche de doctorat réalisée entre 2010 et 2015, dont l’accent a été mis sur les sources matérielles existantes pour l’étude de cette question. Pour cela, une base de données qui rassemble les vestiges religieux identifiés dans les maisons entre le début de la période dynastique et la Basse Époque a été créée.
Les sources rassemblées permettent de nouvelles analyses sur les pratiques religieuses domestiques dans l’Égypte ancienne. Une des idées qui se démarque est la possibilité de connaître ces pratiques non seulement au Nouvel Empire mais aussi au Moyen Empire. Ainsi, cet article présente les sources existantes pour l'étude de la religion domestique au Moyen Empire et systématise les informations issues de ces sources caractérisant ce qu’a été cette pratique au cours de cette période.
La religion domestique dans l’Égypte ancienne a été le thème d’une recherche de doctorat réalisée entre 2010 et 2015, dont l’accent a été mis sur les sources matérielles existantes pour l’étude de cette question. Pour cela, une base de données qui rassemble les vestiges religieux identifiés dans les maisons entre le début de la période dynastique et la Basse Époque a été créée.
Les sources rassemblées permettent de nouvelles analyses sur les pratiques religieuses domestiques dans l’Égypte ancienne. Une des idées qui se démarque est la possibilité de connaître ces pratiques non seulement au Nouvel Empire mais aussi au Moyen Empire. Ainsi, cet article présente les sources existantes pour l'étude de la religion domestique au Moyen Empire et systématise les informations issues de ces sources caractérisant ce qu’a été cette pratique au cours de cette période.
 Household religion in ancient Egypt was the subject of a PhD research carried out from 2010 to 2015, of which the focus was the material sources existent for the study of this issue. For such, a database gathering the remains of religious nature identified in houses between the Early Dynastic Period and the Late Period was created.
The collection of sources allows a new analysis about what were the religious practices in the house in Ancient Egypt. One of the ideas that is emphasized is the possibility of knowing these practices not only in the New Kingdom but also in the Middle Kingdom. Thus, this paper presents the existing sources for the study of household religion in the Middle Kingdom and systematizes the information resulting from these sources characterizing this religious practice during this period.
Household religion in ancient Egypt was the subject of a PhD research carried out from 2010 to 2015, of which the focus was the material sources existent for the study of this issue. For such, a database gathering the remains of religious nature identified in houses between the Early Dynastic Period and the Late Period was created.
The collection of sources allows a new analysis about what were the religious practices in the house in Ancient Egypt. One of the ideas that is emphasized is the possibility of knowing these practices not only in the New Kingdom but also in the Middle Kingdom. Thus, this paper presents the existing sources for the study of household religion in the Middle Kingdom and systematizes the information resulting from these sources characterizing this religious practice during this period.
 Consulter cet article (38882) -
Consulter cet article (38882) -  Télécharger cet article au format pdf (20869)
Télécharger cet article au format pdf (20869)
« Dealing with Problematic Texts. A Synoptic Study of the Hypocephalus Turin Cat. 2320 »
ENiM 12, 2019, p. 49-73.
 Une étude des textes de l’hypocéphale Turin Cat. 2320, probablement daté de la période ptolémaïque, est présentée dans cet article en considérant les variantes dans autres exemplaires. D’autres types de textes autour du bord des hypocéphales, par exemple ceux consacrés à Djebaty, ou comportant des extraits du chapitre 162 du Livre des Morts, présentent des significations plus canoniques. Des références intéressantes aux principales composantes du défunt – ka, ba, akh et le corps – peuvent être identifiées dans les textes autour du bord et dans les divers registres. Particulièrement intéressant est le concept de ba d’Amon qui devient la multiplicité de l’univers et qui, comme l’a souligné Jan Assmann, a été dérivé par les prêtres thébains de la période ramesside de l’idée amarnienne de « un et un million ».
Une étude des textes de l’hypocéphale Turin Cat. 2320, probablement daté de la période ptolémaïque, est présentée dans cet article en considérant les variantes dans autres exemplaires. D’autres types de textes autour du bord des hypocéphales, par exemple ceux consacrés à Djebaty, ou comportant des extraits du chapitre 162 du Livre des Morts, présentent des significations plus canoniques. Des références intéressantes aux principales composantes du défunt – ka, ba, akh et le corps – peuvent être identifiées dans les textes autour du bord et dans les divers registres. Particulièrement intéressant est le concept de ba d’Amon qui devient la multiplicité de l’univers et qui, comme l’a souligné Jan Assmann, a été dérivé par les prêtres thébains de la période ramesside de l’idée amarnienne de « un et un million ».
 A study of the texts in the hypocephalus Turin Cat. 2320, probably dated to the Ptolemaic period, is presented in this paper considering variants in other examples. Other types of texts around the rim of hypocephali, for example those devoted to Djebaty, or with excerpts from spell 162 of the Book of the Dead, present more canonical meanings. Interesting references to the main components of the deceased – ka, ba, akh, and the corpse – can be identified in the texts around the rim and in the various registers. Noteworthy, in particular, is the concept of the ba of Amun that becomes the multiplicity of the universe, which, as Jan Assmann indicated, the Theban clergy of the Ramesside period developed from the Amarnian idea of “One-and-million”.
A study of the texts in the hypocephalus Turin Cat. 2320, probably dated to the Ptolemaic period, is presented in this paper considering variants in other examples. Other types of texts around the rim of hypocephali, for example those devoted to Djebaty, or with excerpts from spell 162 of the Book of the Dead, present more canonical meanings. Interesting references to the main components of the deceased – ka, ba, akh, and the corpse – can be identified in the texts around the rim and in the various registers. Noteworthy, in particular, is the concept of the ba of Amun that becomes the multiplicity of the universe, which, as Jan Assmann indicated, the Theban clergy of the Ramesside period developed from the Amarnian idea of “One-and-million”.
 Consulter cet article (38947) -
Consulter cet article (38947) -  Télécharger cet article au format pdf (20027)
Télécharger cet article au format pdf (20027)
« “Agir en mâle, Ă©tant une femme” »
ENiM 13, 2020, p. 311-317.
 L’expression « femme agissant en homme » sert à décrire Isis, Sekhmet, Ouadjet et Neith dans six textes, datés à partir du milieu du IVe siècle avant J.-C. Cette formulation a pu être comprise comme une appropriation par ces déesses d’un rôle sexuel et génésique masculin, ou comme une référence à une androgynie démiurgique.
Cet article examine l’ensemble des documents pour y noter la prévalence des thèmes de la peur, de la protection et de « l’Œil de Ré ». Le contraste entre l’identité sexuelle des déesses et le genre masculin de leur comportement ne relève pas d’un geste viril spécifique, mais vise à produire une rupture de la norme, qui les place en situation d’altérité et d’étrangeté, ce qui inspire l’effroi.
L’expression « femme agissant en homme » sert à décrire Isis, Sekhmet, Ouadjet et Neith dans six textes, datés à partir du milieu du IVe siècle avant J.-C. Cette formulation a pu être comprise comme une appropriation par ces déesses d’un rôle sexuel et génésique masculin, ou comme une référence à une androgynie démiurgique.
Cet article examine l’ensemble des documents pour y noter la prévalence des thèmes de la peur, de la protection et de « l’Œil de Ré ». Le contraste entre l’identité sexuelle des déesses et le genre masculin de leur comportement ne relève pas d’un geste viril spécifique, mais vise à produire une rupture de la norme, qui les place en situation d’altérité et d’étrangeté, ce qui inspire l’effroi.
 Isis, Sekhmet, Ouadjet and Neith are described as « women behaving as men » in six texts dating back to the middle of the IV century bc. This has been understood as a reference to goddesses taking on a specifically male sexual and reproductive function, or as an allusion to the androgyny of the creator god.
This article examines how all these documents focus on fear, protection and the theme of the “Eye of Re”. The contrast between sexual identity and gendered behavior does not refer to a specific masculine act, but intends to create a breach in normativity, which puts these goddesses in a state of otherness and strangeness, causing fright.
Isis, Sekhmet, Ouadjet and Neith are described as « women behaving as men » in six texts dating back to the middle of the IV century bc. This has been understood as a reference to goddesses taking on a specifically male sexual and reproductive function, or as an allusion to the androgyny of the creator god.
This article examines how all these documents focus on fear, protection and the theme of the “Eye of Re”. The contrast between sexual identity and gendered behavior does not refer to a specific masculine act, but intends to create a breach in normativity, which puts these goddesses in a state of otherness and strangeness, causing fright.
 Consulter cet article (38620) -
Consulter cet article (38620) -  Télécharger cet article au format pdf (19455)
Télécharger cet article au format pdf (19455)
« Lion ou chat ? La reprĂ©sentation des fĂ©lines dans les ex-voto Ă Bastet/Boubastis Ă l’époque ptolĂ©maĂŻque »
ENiM 17, 2024, p. 135-159.
 Bastet a été représentée jusqu’à la Basse Époque comme une lionne en raison de son lien théologique avec Sekhmet. Ensuite la déesse prend la forme d’une chatte alors que sa fonction protectrice devient prédominante dans le culte de Delta. Ce changement est surtout visible dans les ex-voto (bronzes de chat ou lionne, statuettes de Bastet avec le sistre et l’égide...) que les Égyptiens offrent dans les temples de Bastet pour demander la protection des femmes enceintes et des enfants.
À l’époque gréco-romaine, la popularité du culte de Bastet a conduit à l’augmentation de la production de ces objets votifs que les ateliers grecs locaux ont réélaborés avec une iconographie et un style (des félines) plus « réaliste ». Puis l’image du chat et du lion s’est répandue dans toute la Méditerranée comme symbole de la déesse hellénisée Isis-Boubastis.
Dans cet article, l’iconographique des deux principales classes d’ex-voto à Bastet / Boubastis d’époque gréco-romaine, les statuettes de chat et de lion, sont analysées pour montrer la différence de représentation entre les deux félins (détails du corps, du museau, des oreilles, de la posture) et le changement iconographique entre les productions ptolémaïque / romaine et pharaoniques.
En outre, une attention particulière est portée à certains types de statuettes où les félins sont figurés avec des attitudes dotées d’une signification symbolique et religieuse relative au culte de Boubastis à l’époque gréco-romaine ; par exemple, les statuettes de chats allaitant des chatons, emblème de la protection des enfants par la déesse.
Bastet a été représentée jusqu’à la Basse Époque comme une lionne en raison de son lien théologique avec Sekhmet. Ensuite la déesse prend la forme d’une chatte alors que sa fonction protectrice devient prédominante dans le culte de Delta. Ce changement est surtout visible dans les ex-voto (bronzes de chat ou lionne, statuettes de Bastet avec le sistre et l’égide...) que les Égyptiens offrent dans les temples de Bastet pour demander la protection des femmes enceintes et des enfants.
À l’époque gréco-romaine, la popularité du culte de Bastet a conduit à l’augmentation de la production de ces objets votifs que les ateliers grecs locaux ont réélaborés avec une iconographie et un style (des félines) plus « réaliste ». Puis l’image du chat et du lion s’est répandue dans toute la Méditerranée comme symbole de la déesse hellénisée Isis-Boubastis.
Dans cet article, l’iconographique des deux principales classes d’ex-voto à Bastet / Boubastis d’époque gréco-romaine, les statuettes de chat et de lion, sont analysées pour montrer la différence de représentation entre les deux félins (détails du corps, du museau, des oreilles, de la posture) et le changement iconographique entre les productions ptolémaïque / romaine et pharaoniques.
En outre, une attention particulière est portée à certains types de statuettes où les félins sont figurés avec des attitudes dotées d’une signification symbolique et religieuse relative au culte de Boubastis à l’époque gréco-romaine ; par exemple, les statuettes de chats allaitant des chatons, emblème de la protection des enfants par la déesse.
 Until the Late Period, Bastet was represented as a lioness because of her theological link with Sekhmet. Then the goddess took the form of a cat, as her protective function became predominant in the Delta; this change can be seen, above all, in the ex-votos (bronzes of cats or lions, statuettes of Bastet with sistrum and aegis, etc.) that the Egyptians offered in the temples of Bastet to ask for protection for pregnant women and children.
In the Greco-Roman period, the popularity of the cult of Bastet led to an increase in the production of these votive objects, which local Greek workshops reworked with a more “realistic” iconography and style (of felines). The image of the cat and lion then spread throughout the Mediterranean as a symbol of the Hellenised goddess Isis-Boubastis.
In this article I analyse the iconography of the two main classes of ex-voto to Bastet / Boubastis from the Greco-Roman period, the cat and lion statuettes, to show the difference in representation between the two felines (details of the body, muzzle, ears, posture) and the iconographic change between Ptolemaic, Roman and pharaonic productions.
In addition, I focus on a certain classes of statuette in which felines are represented with attitudes and behaviour that have symbolic and religious significance in the cult of Boubastis, for example, the statuettes of cats suckling kittens, an emblem of the goddess’s protection of children.
Until the Late Period, Bastet was represented as a lioness because of her theological link with Sekhmet. Then the goddess took the form of a cat, as her protective function became predominant in the Delta; this change can be seen, above all, in the ex-votos (bronzes of cats or lions, statuettes of Bastet with sistrum and aegis, etc.) that the Egyptians offered in the temples of Bastet to ask for protection for pregnant women and children.
In the Greco-Roman period, the popularity of the cult of Bastet led to an increase in the production of these votive objects, which local Greek workshops reworked with a more “realistic” iconography and style (of felines). The image of the cat and lion then spread throughout the Mediterranean as a symbol of the Hellenised goddess Isis-Boubastis.
In this article I analyse the iconography of the two main classes of ex-voto to Bastet / Boubastis from the Greco-Roman period, the cat and lion statuettes, to show the difference in representation between the two felines (details of the body, muzzle, ears, posture) and the iconographic change between Ptolemaic, Roman and pharaonic productions.
In addition, I focus on a certain classes of statuette in which felines are represented with attitudes and behaviour that have symbolic and religious significance in the cult of Boubastis, for example, the statuettes of cats suckling kittens, an emblem of the goddess’s protection of children.
 Consulter cet article (23679) -
Consulter cet article (23679) -  Télécharger cet article au format pdf (8699)
Télécharger cet article au format pdf (8699)
ENiM 18 - 2025
5 article(s) - 2 avril 2025.
ENiM 1 à 18 (2008-2025) : 224 articles
4 662 052 téléchargements
9 400 011 consulations.
Index des auteurs

Mots clés

Derniers articles : 
Robert Steven Bianchi
Duplication and Continuity
(ENiM 18, p. 13-36 — 11 mars 2025) 
Frédéric Mougenot
Rénénoutet à la porte de la maison
(ENiM 18, p. 1-12 — 29 janvier 2025) 
CENiM - Mise en ligne des volumes Ă©puisĂ©s : 
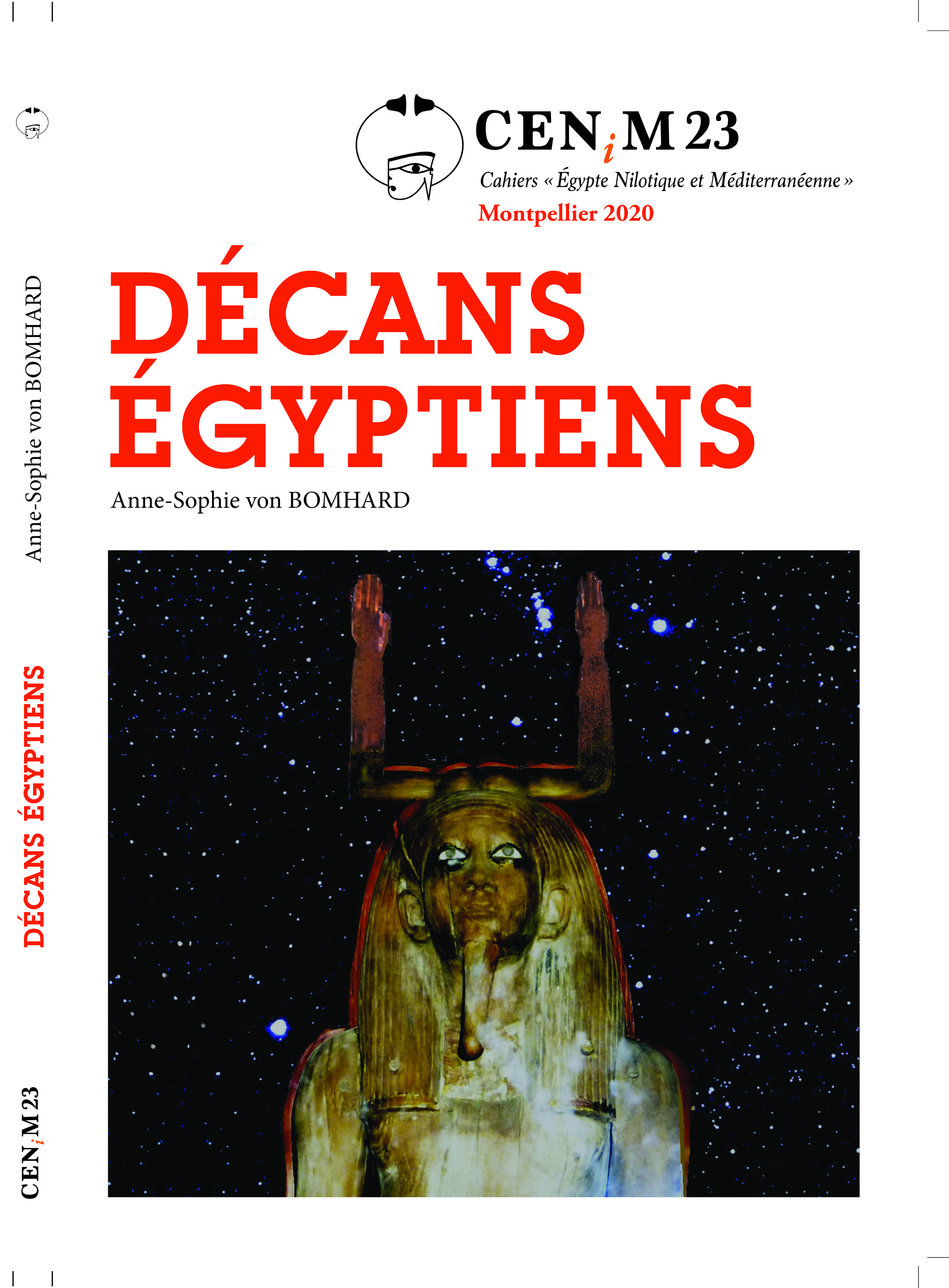 Anne-Sophie von BOMHARD DĂ©cans Ă©gyptiens, CENiM 23, Montpellier, 2020 — (2020)
Anne-Sophie von BOMHARD DĂ©cans Ă©gyptiens, CENiM 23, Montpellier, 2020 — (2020) 
 Jean-Claude Grenier L'Osiris ANTINOOS, CENiM 1, Montpellier, 2008 — (26 dĂ©cembre 2008)
Jean-Claude Grenier L'Osiris ANTINOOS, CENiM 1, Montpellier, 2008 — (26 dĂ©cembre 2008) 
TDENiM - Mise en ligne des volumes Ă©puisĂ©s : 
 Twitter
Twitter 3817042 visites - 662 visite(s) aujourd’hui - 42 connecté(s)
© ENiM - Une revue d’égyptologie sur internet
Équipe Égypte Nilotique et Méditerranéenne - UMR 5140 - « Archéologie des Sociétés Méditerranéennes » (Cnrs) - Université Paul Valéry - Montpellier III






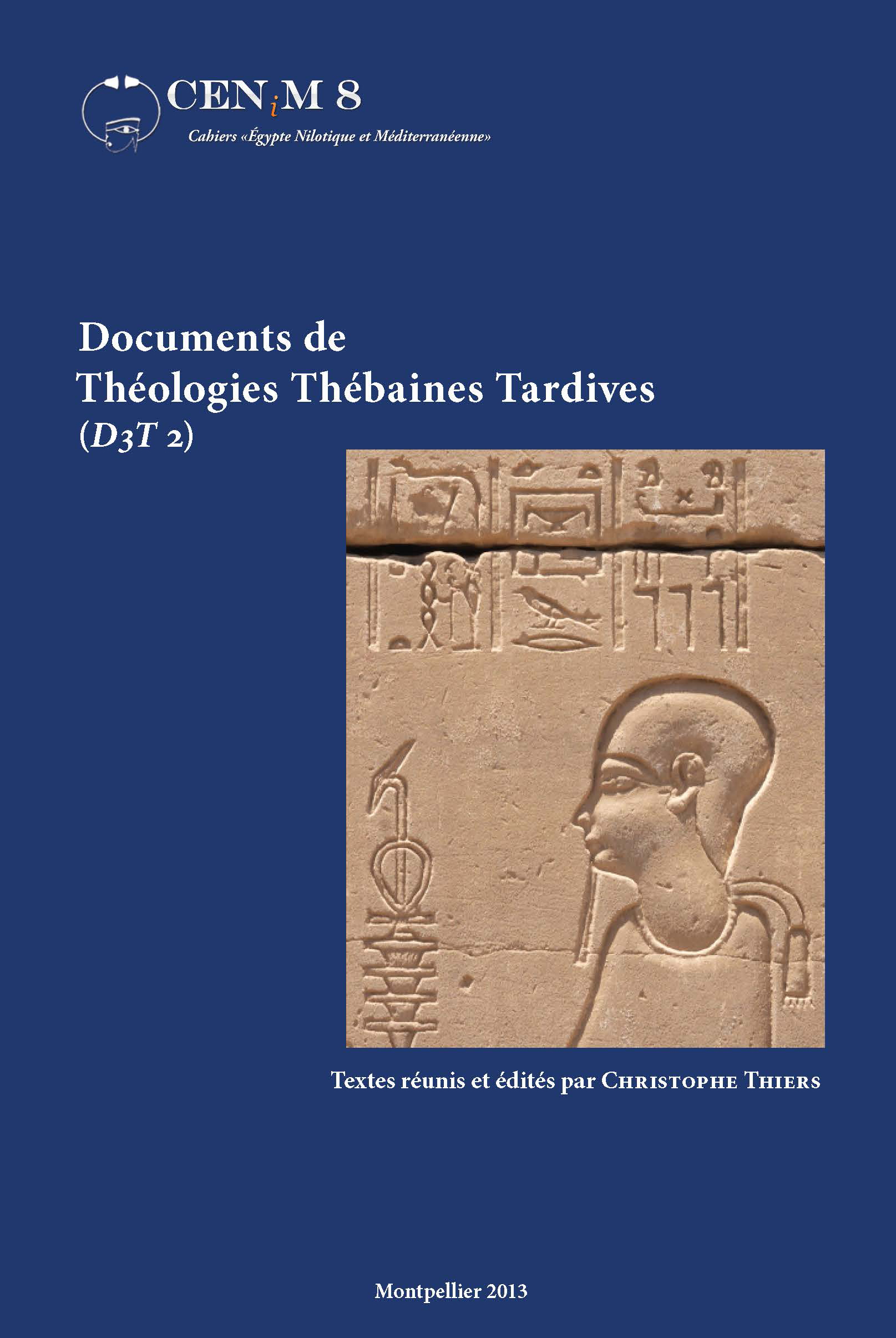


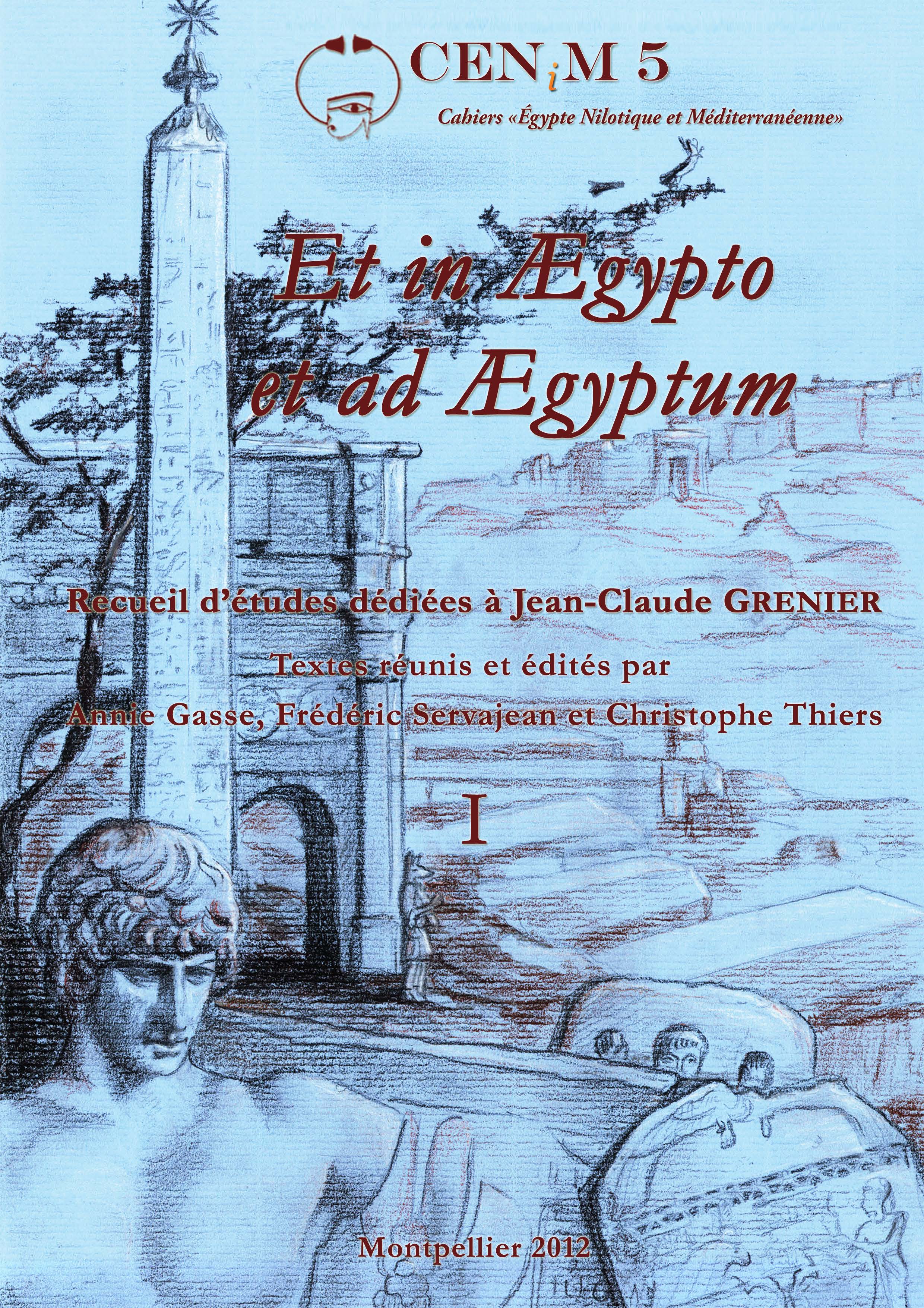
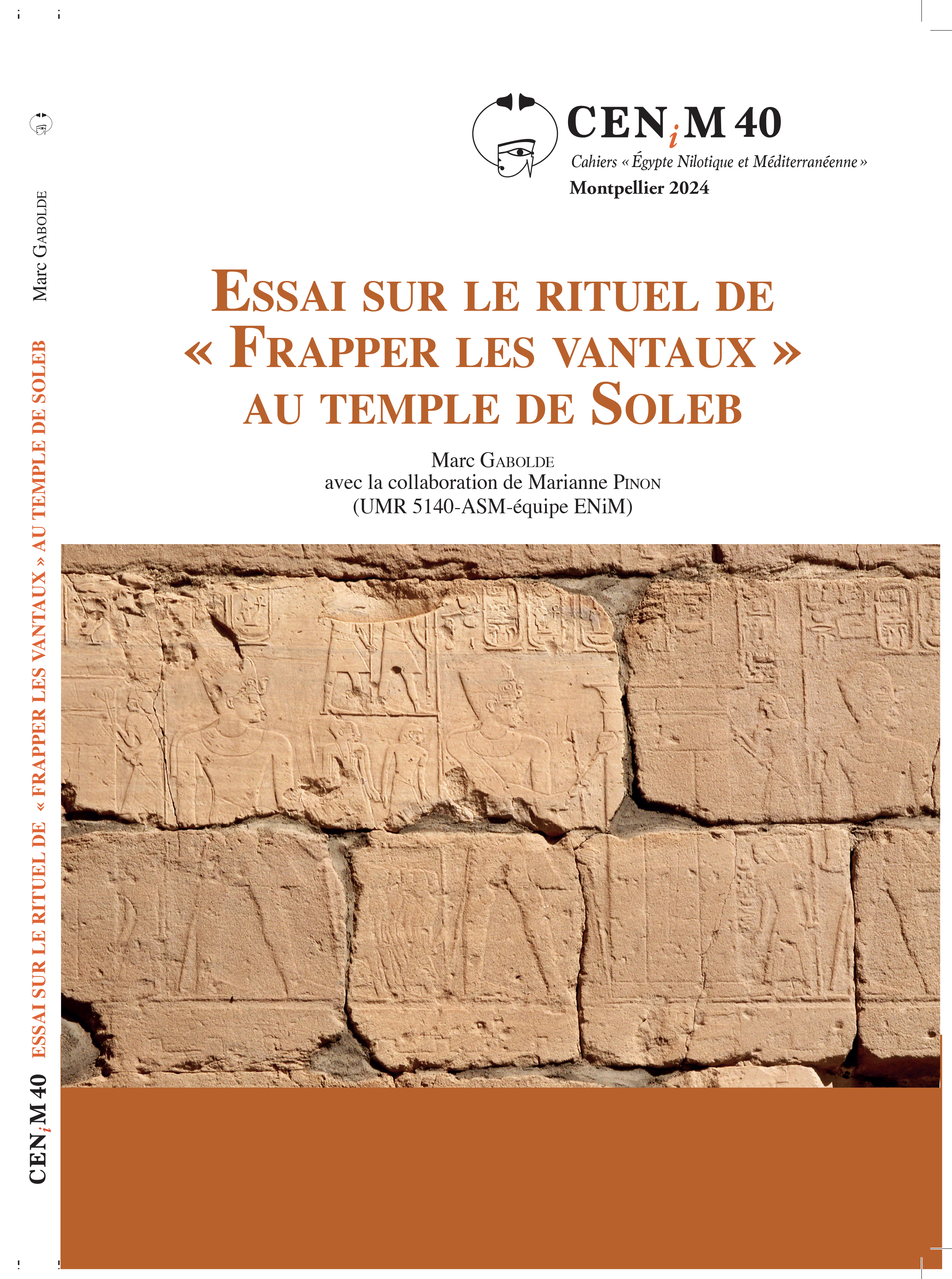

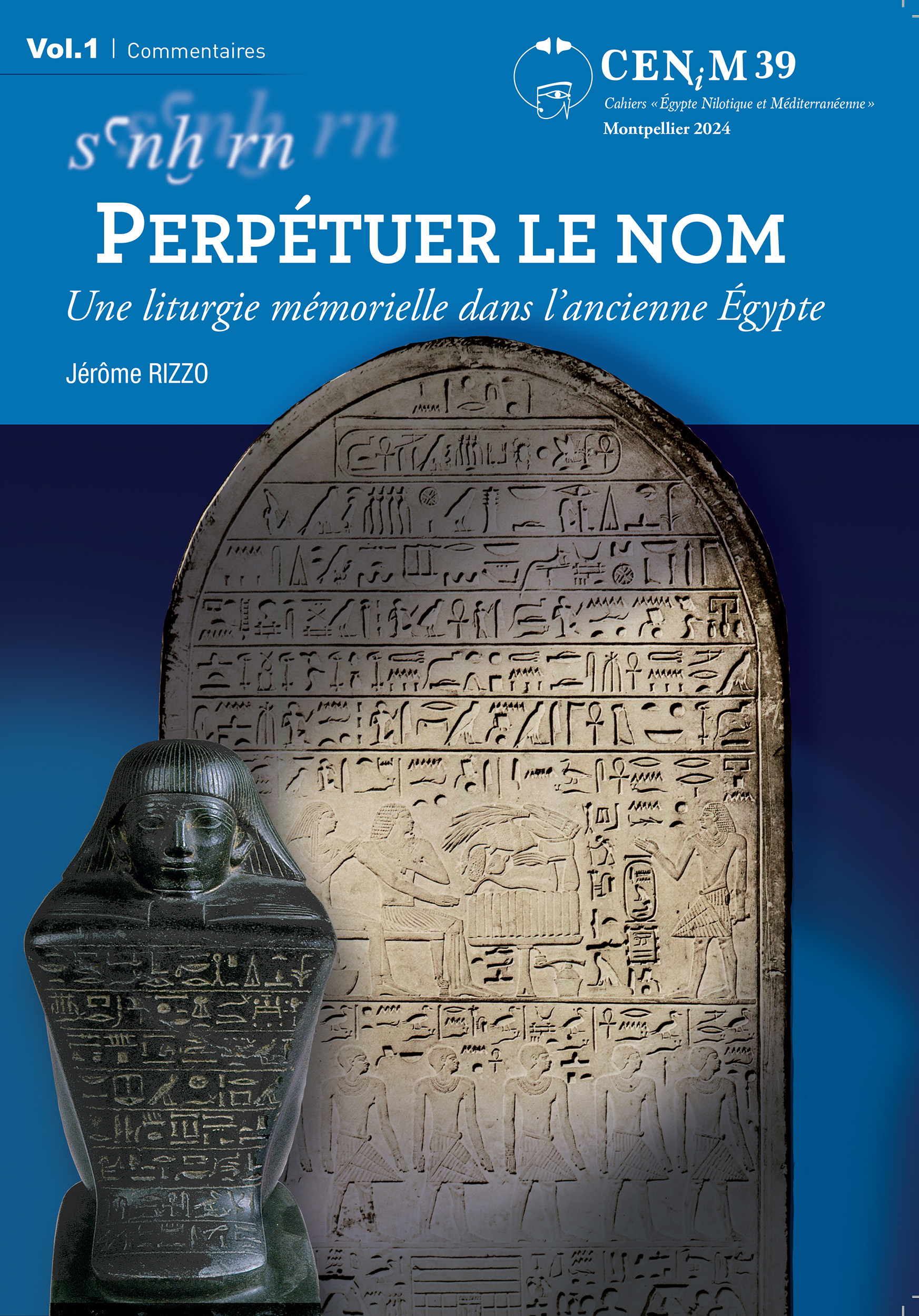
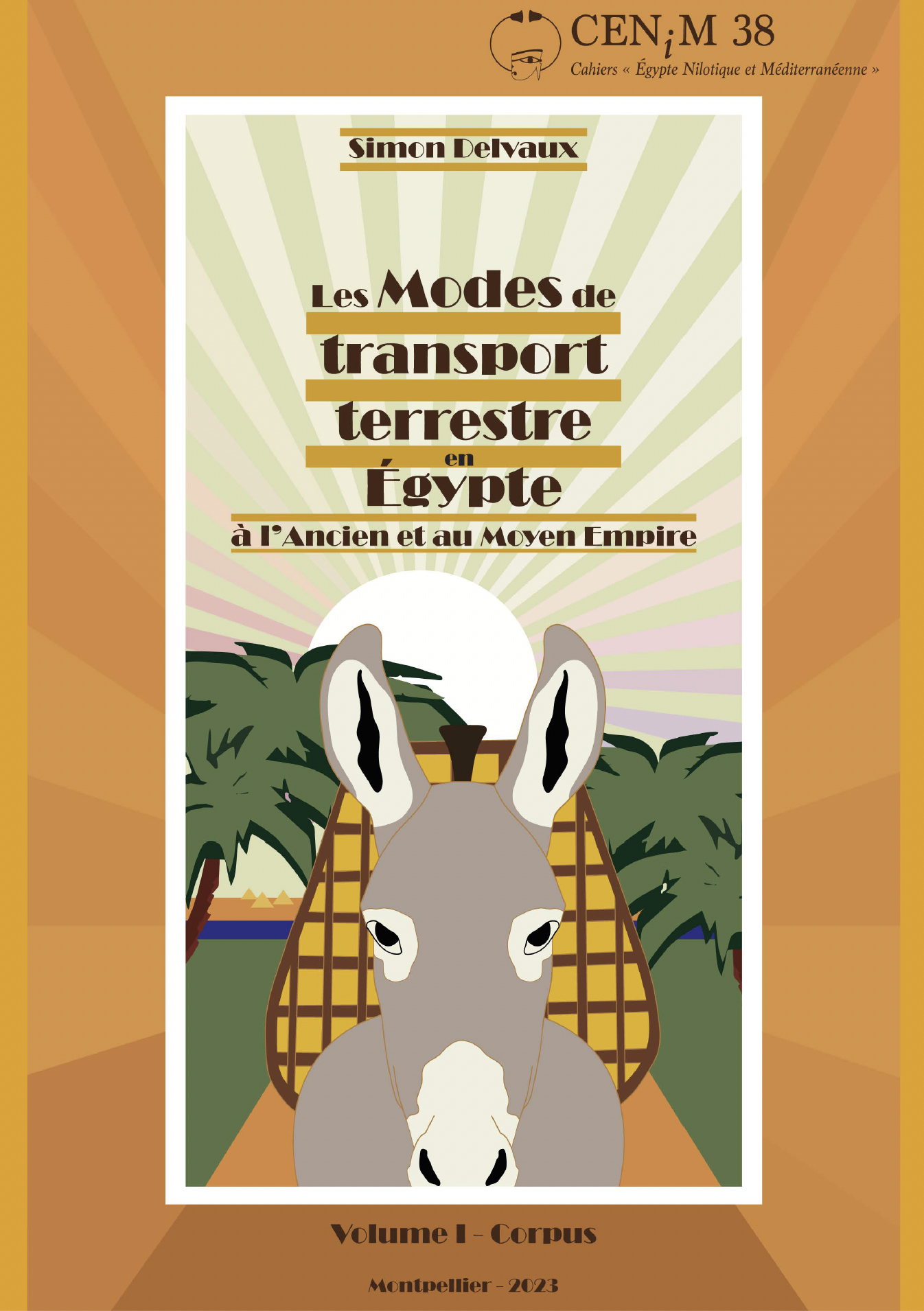
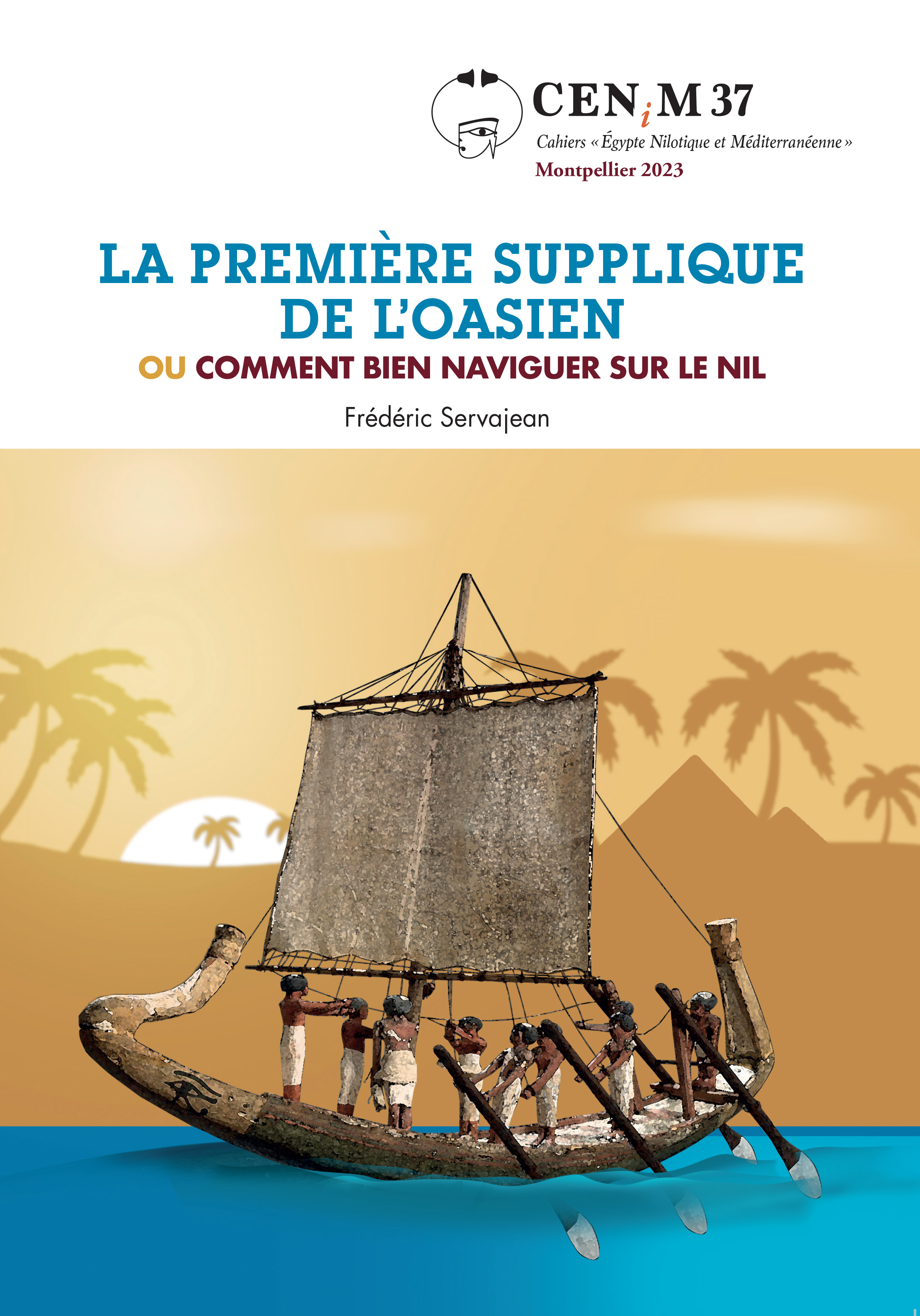
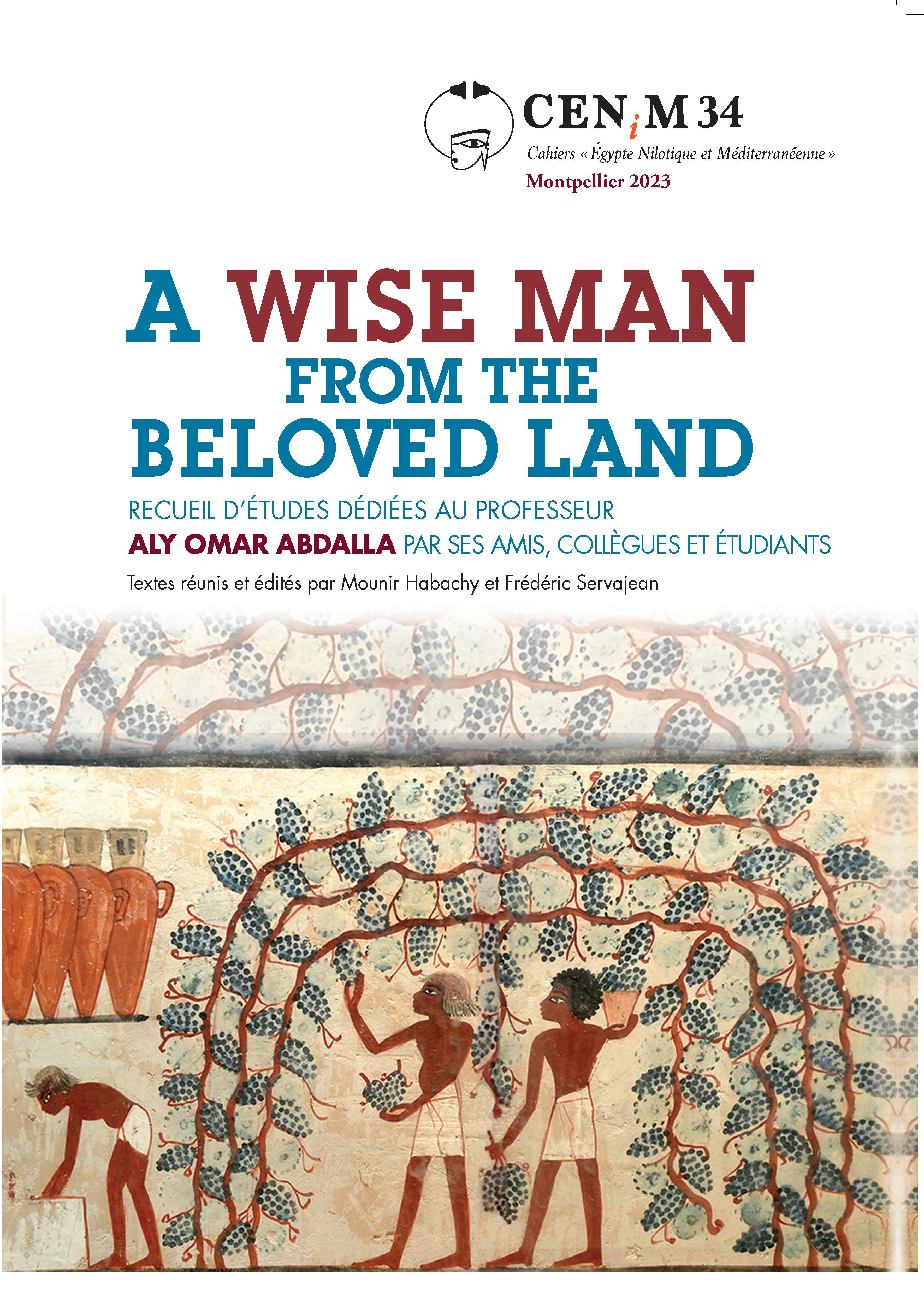
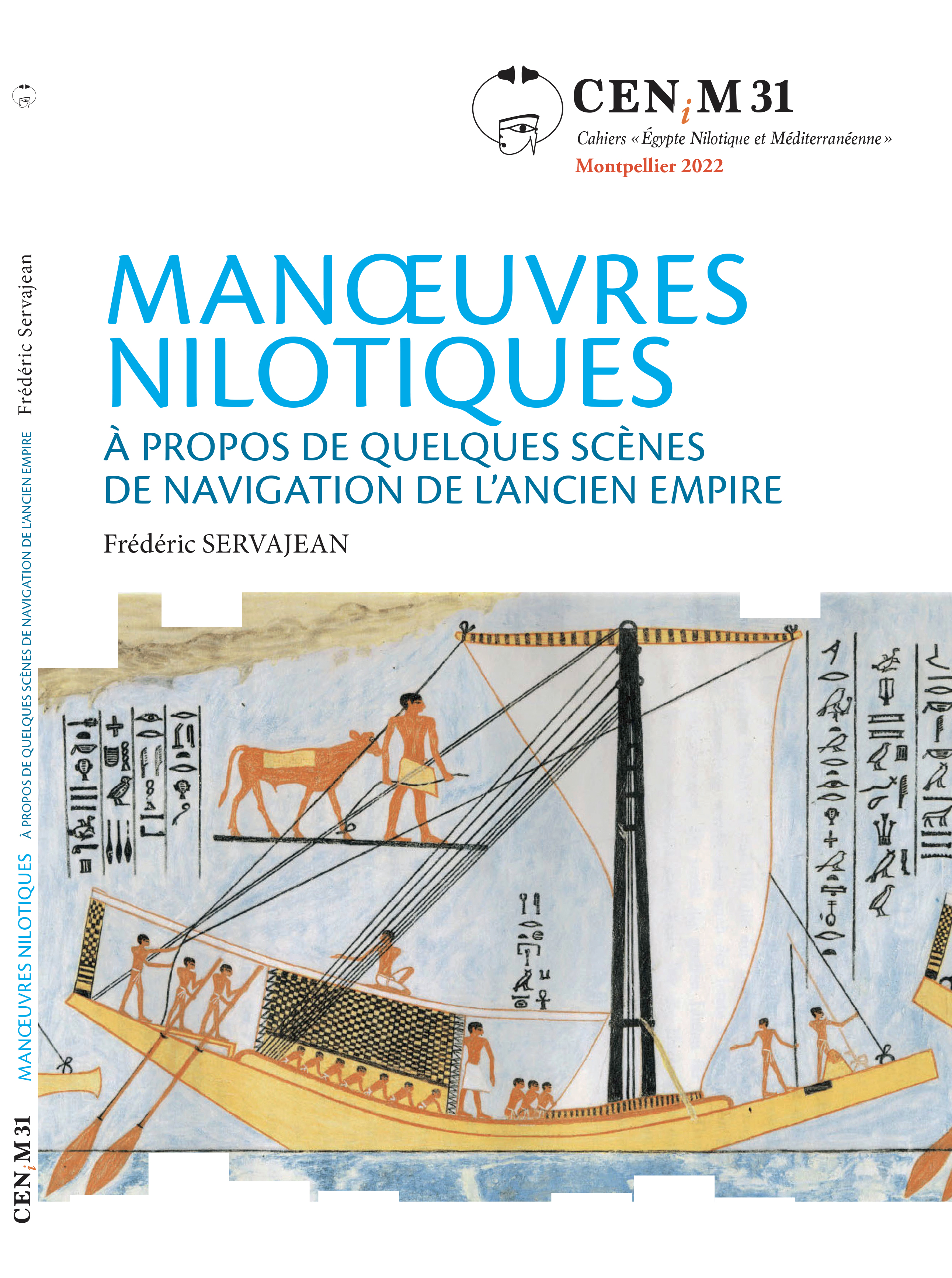
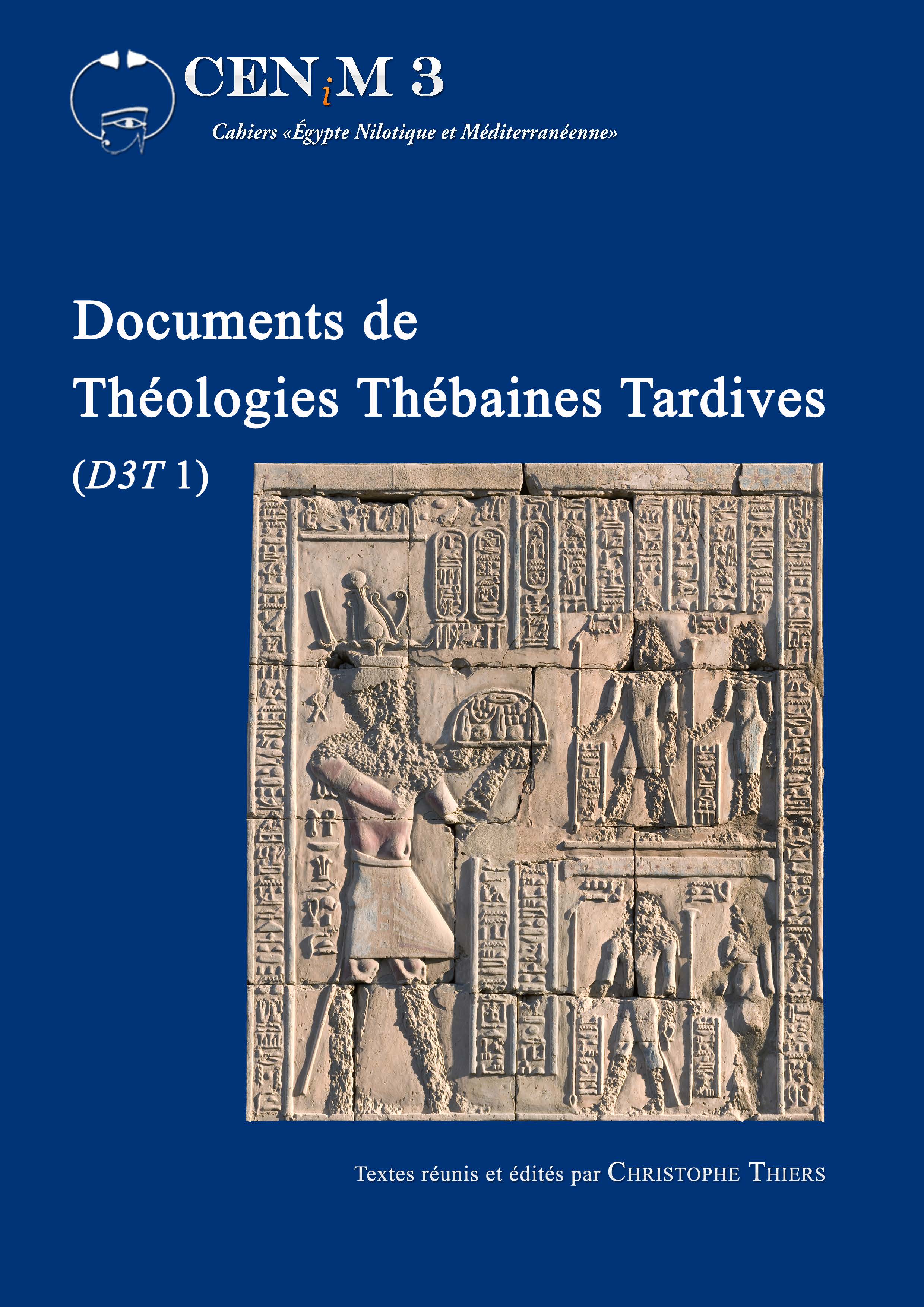
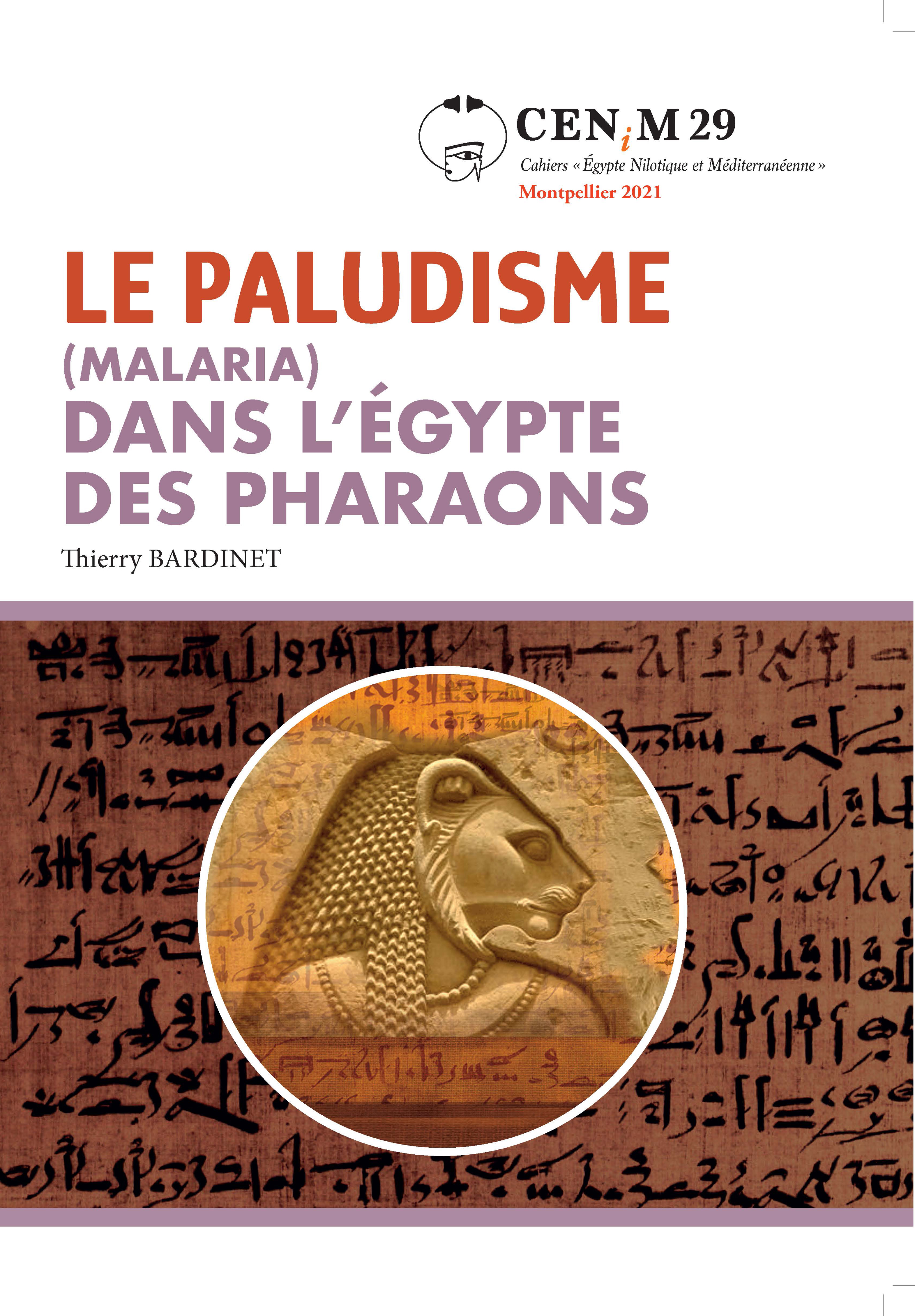
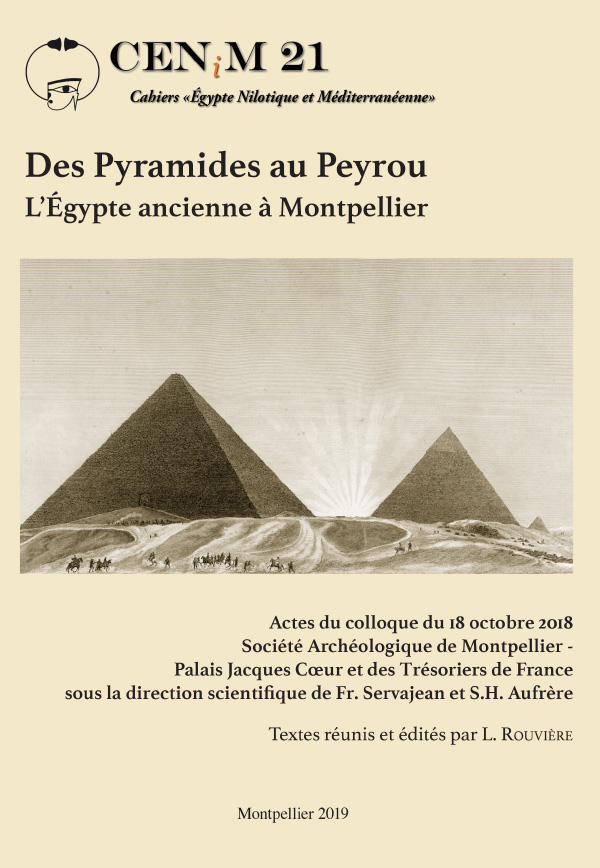
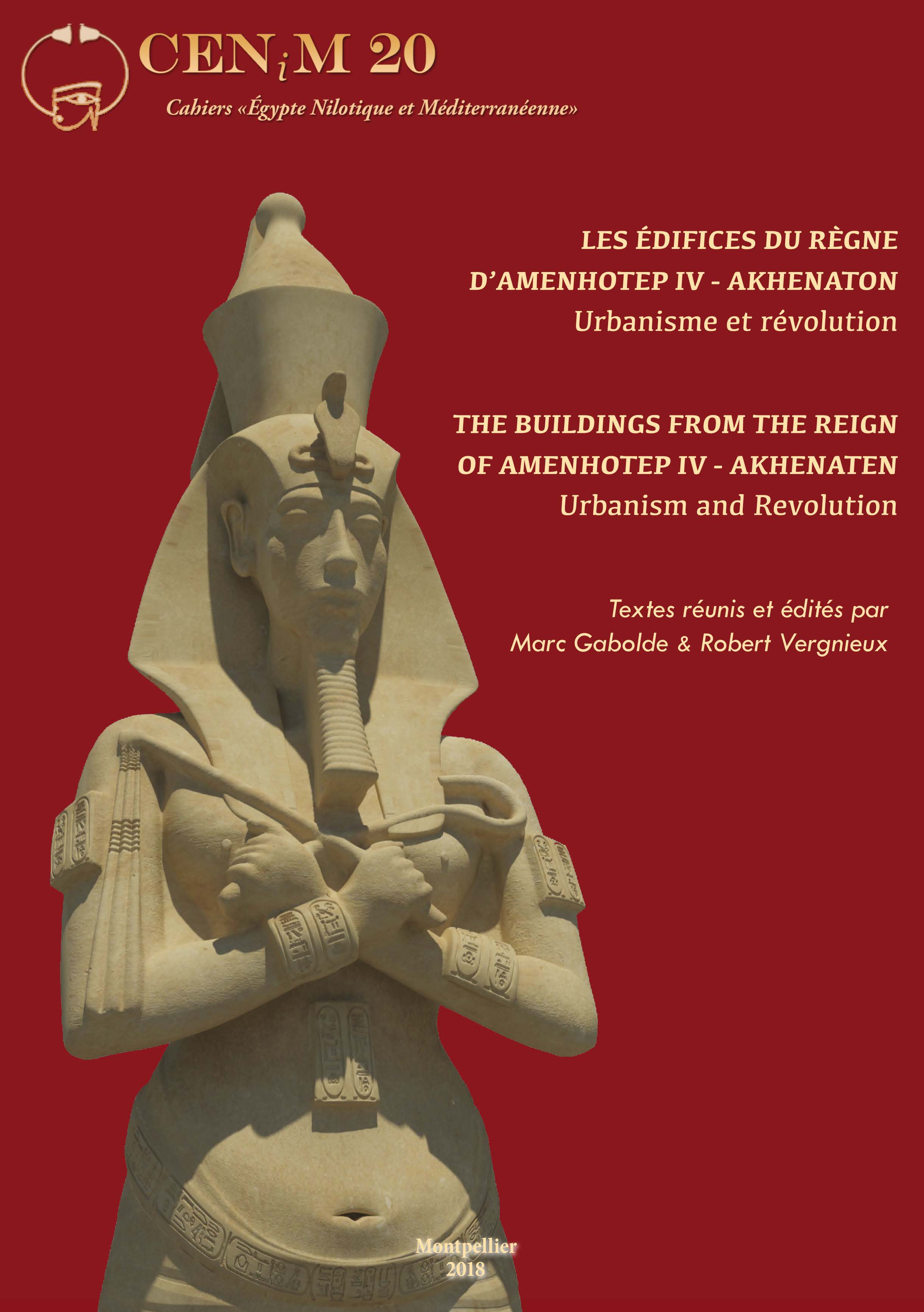
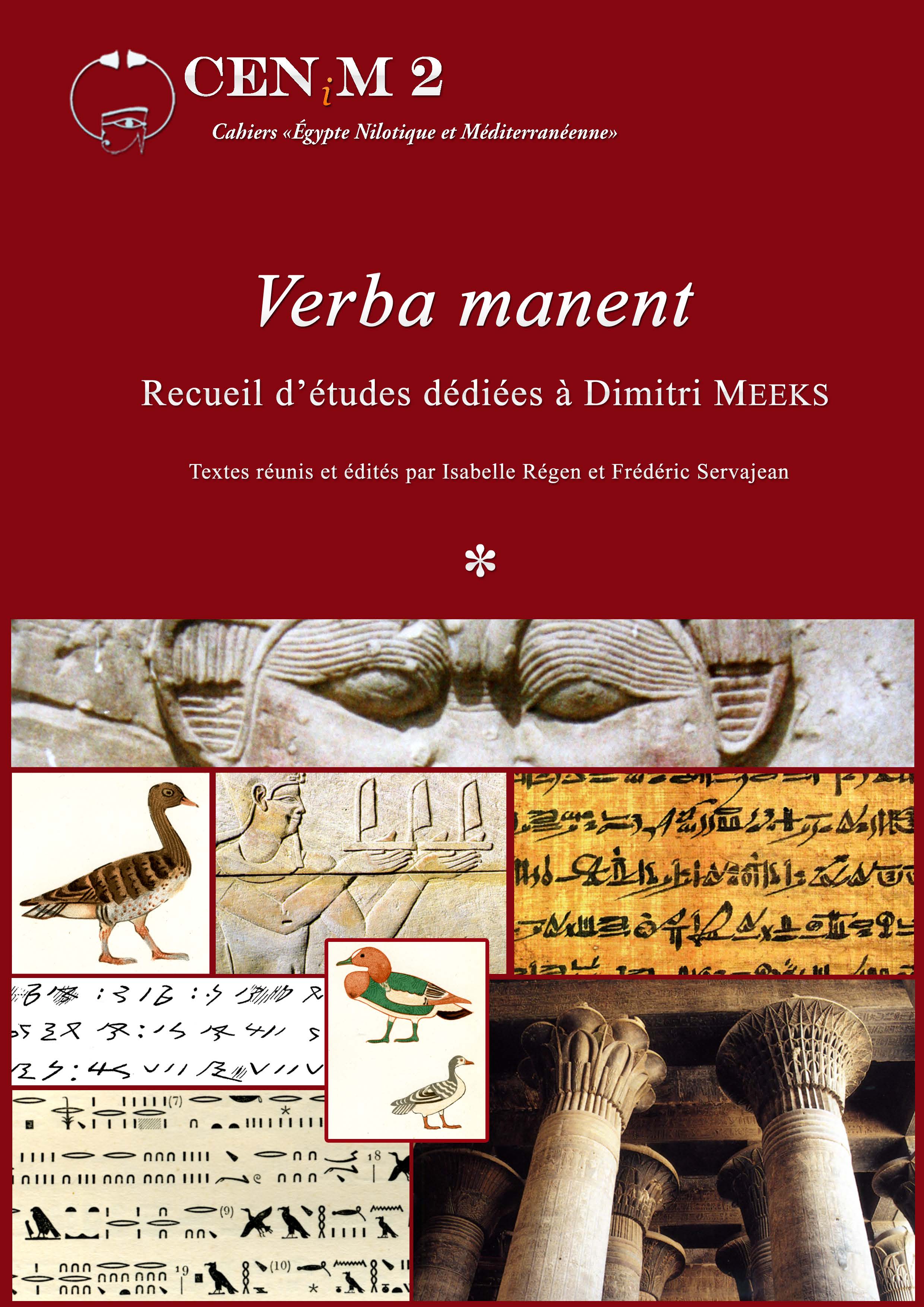
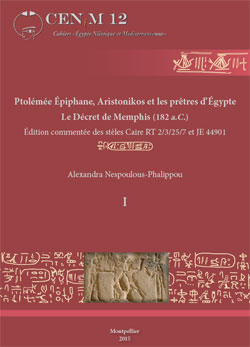
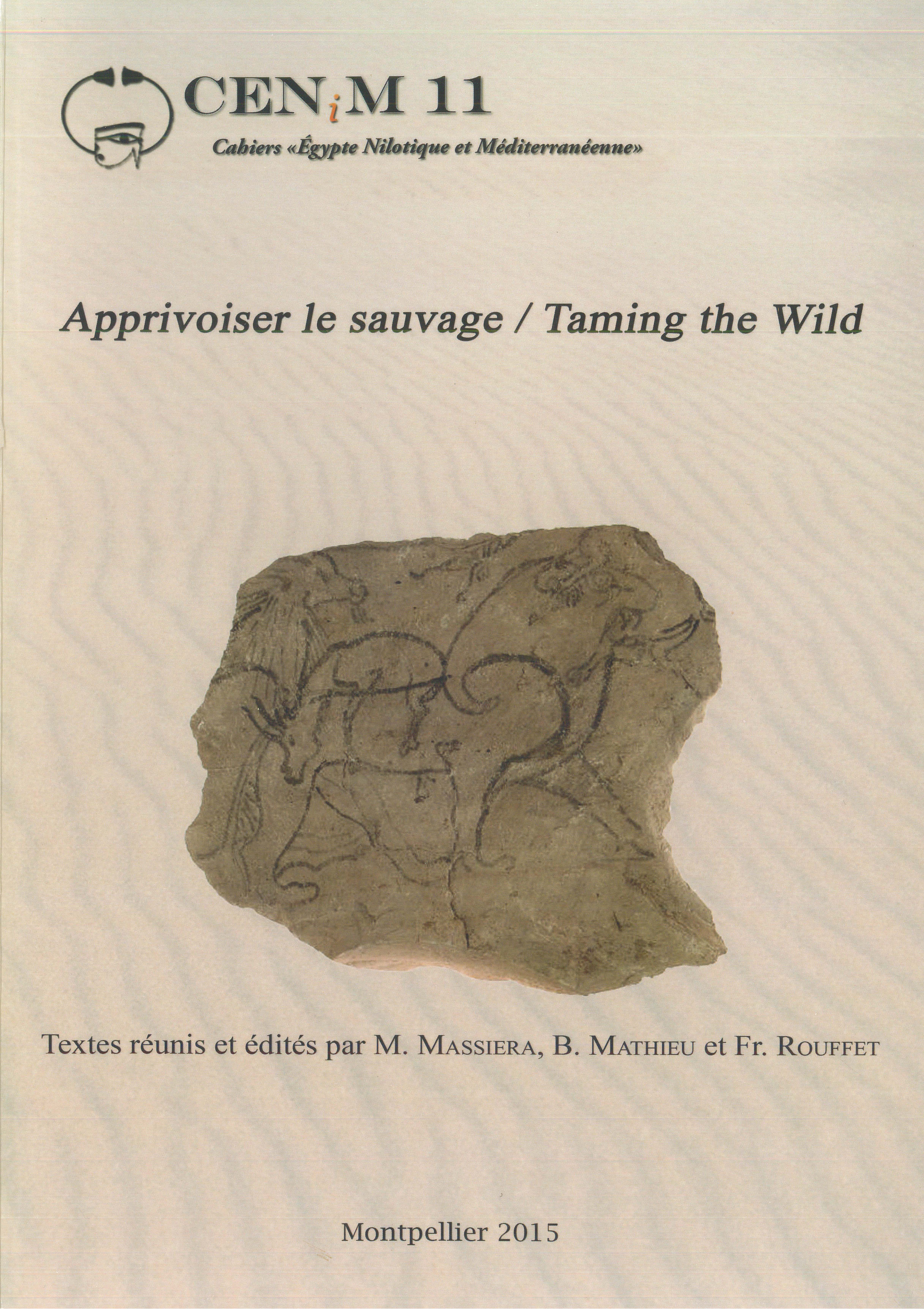
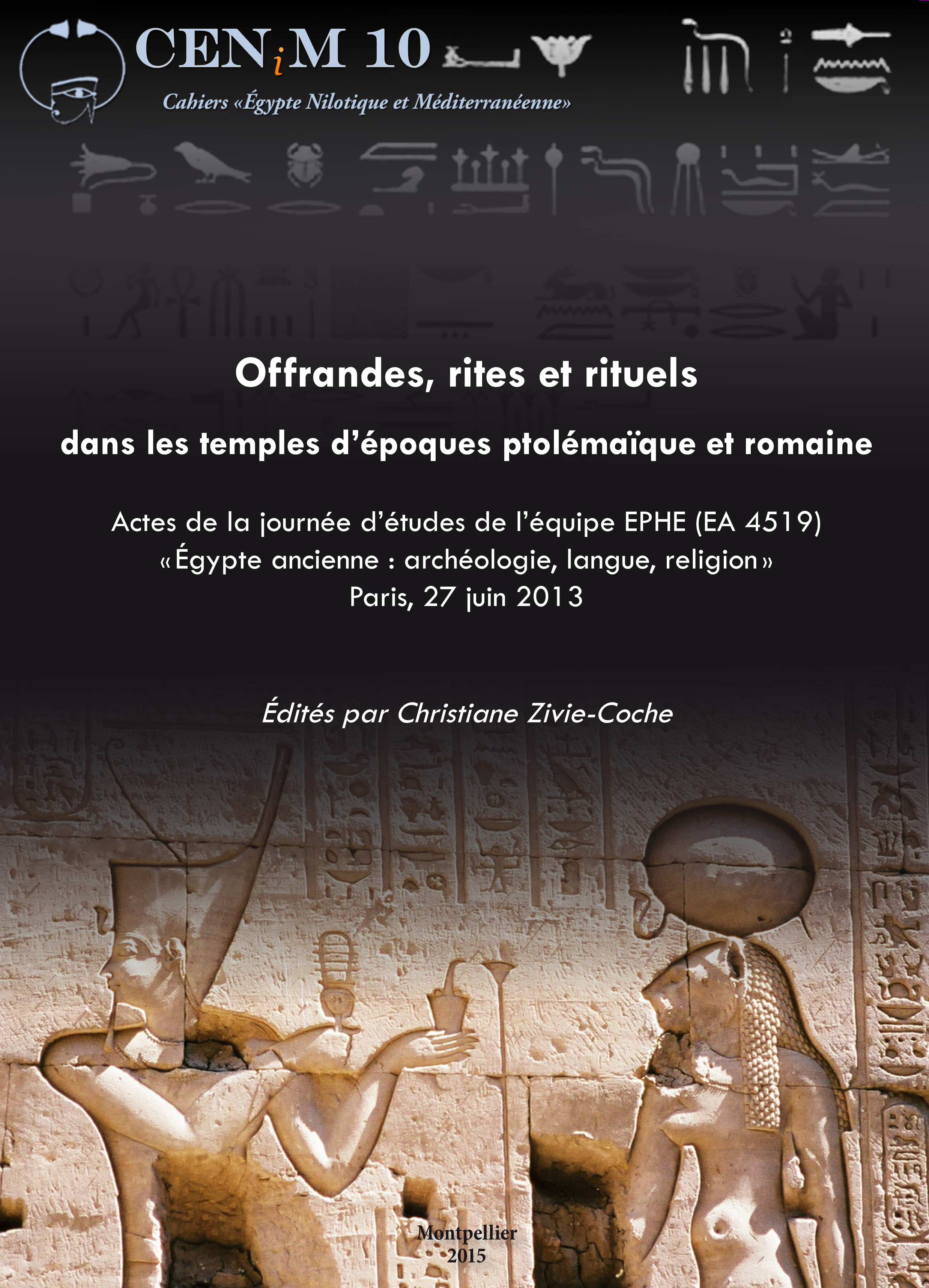
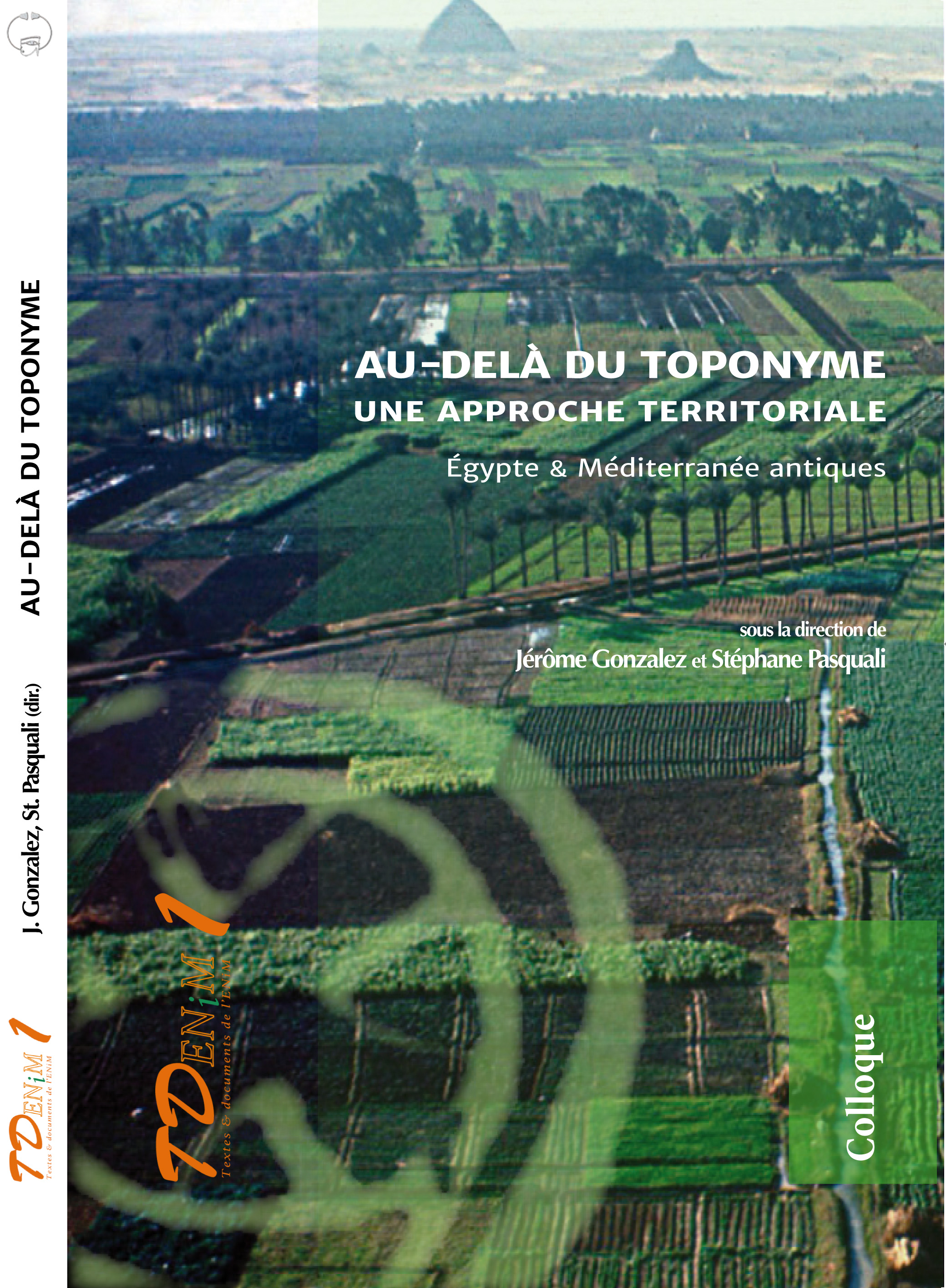
 Contact
Contact
 Abonnez-vous !
Abonnez-vous ! Équipe Égypte Nilotique et Méditerranéenne
Équipe Égypte Nilotique et Méditerranéenne UMR 5140 « Archéologie des Sociétés Méditerranéennes » (Cnrs)
UMR 5140 « Archéologie des Sociétés Méditerranéennes » (Cnrs) Université Paul Valéry - Montpellier III
Université Paul Valéry - Montpellier III